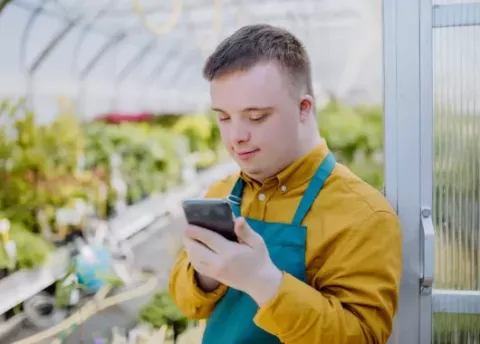Témoignages L’épilepsie, mes études et moi
En bref
- En France, près de 700 000 personnes souffrent d'épilepsie, faisant d'elle l'une des maladies neurologiques les plus fréquentes.
- Comme un orage dans le cerveau, cette maladie court-circuite non seulement les neurones, mais électrise aussi les parcours scolaires et la vie sociale.
- Bérangère*, 20 ans, et Gaspard, 22 ans, tous les deux étudiants, partagent leur expérience et leur détermination à ne pas laisser l’épilepsie les définir.
Chaque épilepsie est différente
« C’est comme une décharge électrique dans le cerveau », explique Bérangère (le prénom a été changé à la demande de l'intéressée), 20 ans, pour décrire ses crises d’épilepsie. Étudiante en deuxième année pour devenir monitrice-éducatrice, elle compose avec l’épilepsie depuis son plus jeune âge : « J’ai eu ma première crise à 18 mois. J’ai une maladie génétique qui s’appelle la sclérose de Bourneville et qui entraîne des troubles, dont l’épilepsie. Un traitement m’avait stabilisée pendant plusieurs années, mais le soir de Noël de mes 11 ans, j’ai refait une crise. J’étais en repas de famille, j’étais descendue chercher quelque chose. Mes parents, inquiets de ne pas me voir venir, m’ont trouvée en pleine crise. J’avais le regard fixe, comme absente. » Beaucoup pensent que l’épilepsie se résume à des convulsions, mais c’est plus complexe. « J’ai connu une fille qui faisait des bisous pendant ses crises et un garçon qui se mettait à courir à toute vitesse. Moi, je reste figée. On devrait parler des épilepsies, plutôt que de l’épilepsie » insiste l’étudiante bretonne. De son côté, Gaspard, 22 ans, étudiant en 3ᵉ année de communication à l’Iscom, fait des crises généralisées tonico-cloniques, « la crise classique que tout le monde connaît avec les bras et les jambes qui bougent dans tous les sens ». Il se souvient de sa première crise à 14 ans, « un matin d’été, juste avant de partir en vacances ». Le diagnostic est rapidement tombé, mettant fin à son rêve de devenir pompier volontaire puis militaire. À la rentrée de 3ᵉ, Gaspard a dû s’adapter à une nouvelle routine, rythmée par la prise quotidienne de médicaments. Malgré les effets secondaires du traitement, son handicap reste peu visible. « La plupart du temps, les crises survenaient le soir. » Jusqu’au jour où, après une période de stabilisation en seconde, une crise est survenue en classe de première devant ses camarades. Cet évènement lui a finalement permis de s’ouvrir davantage sur sa maladie et de renforcer les liens avec son groupe d’amis proches, quitte à l’éloigner parfois des autres élèves. « À l’époque, avec mon épilepsie, je préférais ne pas boire ni fumer, résultat, on me proposait moins de sorties. On me disait souvent : C’est une soirée dans laquelle on va boire, je ne sais pas si ça t’intéresse… »
Vivre avec l’épilepsie
En classe de troisième, Bérangère* s’est sentie rejetée à cause de ses crises, qui survenaient chaque semaine. « Certains de mes camarades disaient que, lorsque j'étais en crise, je ressemblais à un monstre. La plupart des élèves ne faisait preuve d'aucune entraide. Je n’expliquais pas forcément ce qu’était l’épilepsie, car j’avais honte et c’était un phénomène que je ne comprenais pas vraiment non plus. » Elle a alors intégré un internat spécialisé, Toul Ar C’Houat, dans le Finistère, à 40 km de chez elle, où elle s’est enfin sentie « acceptée », « comprise » et sans pour autant que l’épilepsie ne soit « au centre de toutes les conversations ». Sa scolarité de seconde, suivie dans un lycée partenaire, a été sa « plus belle année ». L’établissement était sensibilisé à la maladie et sa classe s’est montrée compréhensive. Cependant, son passage en filière STMG l’année suivante a été difficile et elle a fini par être déscolarisée en avril. Pour Gaspard, les défis sont apparus à l’université. Malgré les démarches entreprises en avance auprès du pôle handicap et du médecin de l’université pour bénéficier d’aménagements, l’administration et les professeurs ont du mal à suivre les directives. Il finit par abandonner sa licence de droit à Assas pour se réorienter vers la communication. La mère de Gaspard, Marion Richard, aujourd’hui vice-présidente de la fondation française pour la recherche sur l’épilepsie (FFRE), milite pour une meilleure connaissance de l’épilepsie. Elle insiste sur l’importance d’un accompagnement adapté et rappelle que « fatigue et stress sont des facteurs bien connus pour déclencher des crises ». Son combat vise aussi à dissiper les idées reçues, comme celle, dangereuse, de vouloir tenir la langue d’une personne en crise.
Focus
Épilepsie et reconnaissance de handicap
La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé se demande auprès de la MDPH de son lieu de résidence avec un dossier complet. Elle permet d’accéder à des aides, des stages de formation et facilite l’accès à l’emploi grâce à l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés dans les entreprises de plus de 20 salariés. Elle offre également une meilleure protection en cas de licenciement et des aménagements de travail.
Briser les idées reçues et les barrières
« L’épilepsie fait partie de moi, c’est un petit truc en plus, mais je ne veux pas que ça me définisse. Sur un lieu de stage, je ne me présente pas comme Bérangère, l’épileptique. Cependant, depuis Toul Ar C’Houat, j’ai appris à expliquer mon épilepsie à chaque fois que j’arrive dans un nouvel endroit », confie Bérangère. Gaspard, lui, a appris cette leçon à ses dépens. « Lors de mon premier stage, je n’avais rien dit. Ils l’ont découvert quand j’ai fait une crise », raconte-t-il. Son patron l’a réprimandé plus tard pour ne pas en avoir parlé. « J’ai compris que c’était une erreur de ma part. Maintenant, je préfère que tout le monde soit au courant », reconnait-il. Il prend aussi soin d’expliquer les gestes à adopter. « Je les rassure : si une crise survient, il suffit d’écarter les objets autour de moi, éventuellement de mettre quelque chose sous ma tête pour éviter que je me cogne par terre et me mettre en position latérale de sécurité », énumère Gaspard. « Une crise dure environ cinq minutes, et il me faut au maximum une heure pour m’en remettre. Ensuite, je peux reprendre mon travail. L’épilepsie ne doit pas dicter ma vie » insiste l’étudiant qui projette de travailler en politique. Bérangère, qui a désormais son propre appartement à Brest, partage cette philosophie et ne laisse pas la maladie freiner ses ambitions : « L’an dernier, j’ai fait un stage au Québec seule. J’ai même fait des randonnées en montagne hors saison. » Un défi pour elle et ses parents « très protecteurs », mais ce n’est qu’un début. « Après mon diplôme, j’aimerais travailler à l’étranger, peut-être en Afrique ou au Maroc », rêve-t-elle. « Je teste un nouveau traitement depuis deux mois, j’espère que les crises se stabiliseront. Mais quoi qu’il arrive, je reste sereine. »
* le prénom a été changé à la demande de l'intéressée