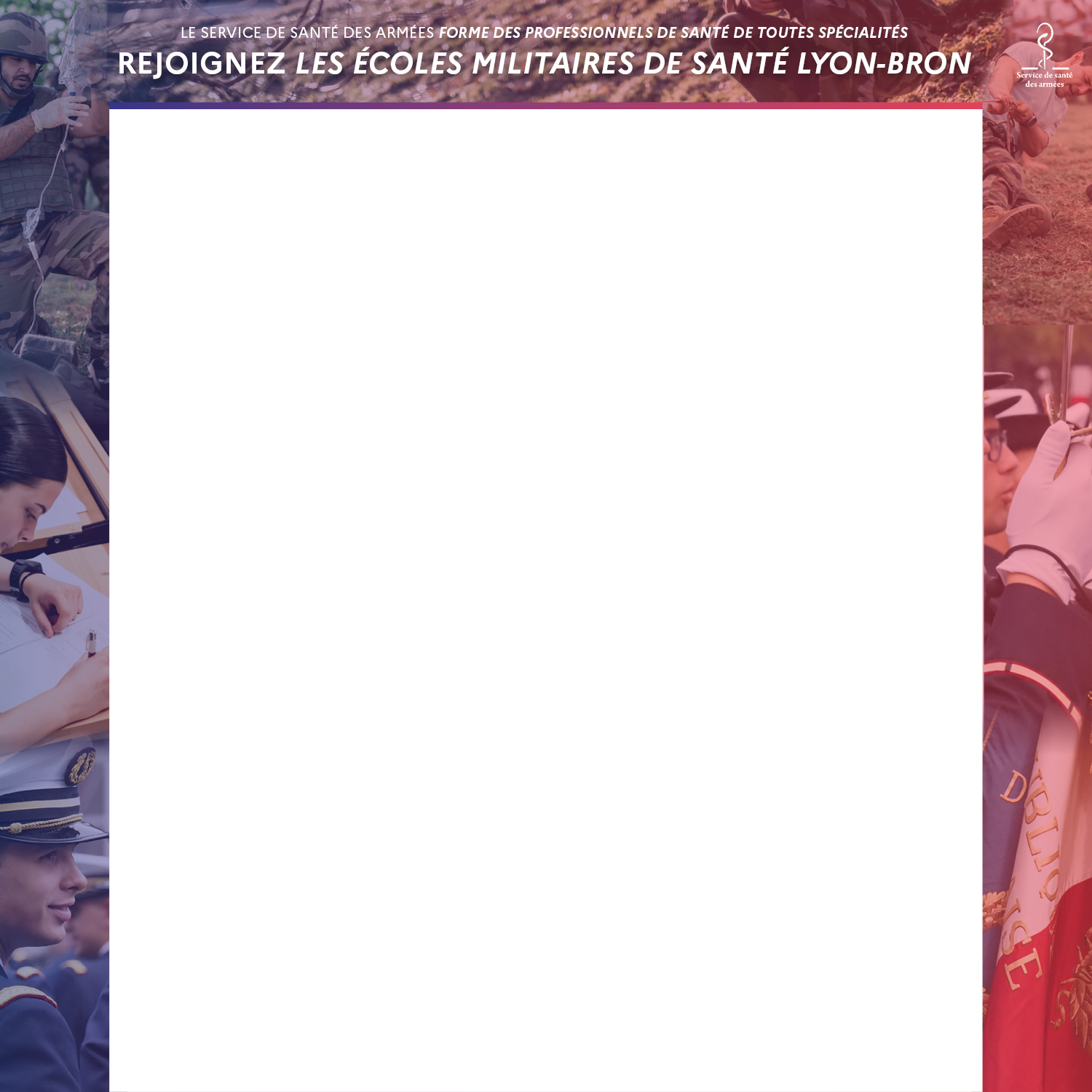L'art de bifurquer Changer de vie pour en sauver d'autres : des (re)convertis à la médecine témoignent
En bref
- Alors que de nombreux métiers du secteur de la santé peinent à attirer de nouveaux talents, certains trentenaires n'hésitent pas à changer de voie pour reprendre de longues études de médecine.
- Un choix audacieux qui implique une charge de travail conséquente.
- Cela exige également un investissement important, aussi bien sur le plan moral que financier.
Devenir médecin à 30 ans : une vocation tardive, mais réfléchie
Si Kévin se retrouve aujourd’hui à 30 ans sur les bancs de la faculté de médecine de Tours, c'est tout sauf un hasard. La médecine a toujours été « dans un coin de (sa) tête ». Pourtant, l’étudiant n’a pas pris le chemin le plus court pour y arriver : après le bac, il s’oriente vers une classe préparatoire dans le prestigieux lycée Louis le grand puis une école d’ingénieur à l’ISAE-SUPAERO à Toulouse suivi d’un doctorat ainsi que de premières expériences professionnelles au Commissariat à l'énergie atomique (CEA) et chez General Electric. Un parcours sans faute, mais non sans frustration. « En fin d’études d’ingénieur, je pensais encore à la médecine. Je me suis alors orienté vers l’imagerie médicale pour mon stage de fin d’études et ma thèse en pensant que c’était un bon compromis », explique-t-il. Mais rapidement, ça ne lui suffit plus : « Il me manquait le côté diagnostic et le contact avec les patients. Le métier d’ingénieur est très utile, mais je ne me sentais pas à ma place derrière un ordinateur ». Au gré de ses recherches sur Internet, il découvre le dispositif Passerelle. Cette modalité d’admission permet d’accéder directement en 2ᵉ ou plus rarement en 3ᵉ année d’une des quatre filières du cursus santé (médecine, pharmacie, odontologie, maïeutique) sans suivre la formation de première année en PASS ou L.AS, ni passer les examens correspondants. Ce dispositif s’adresse aussi bien aux titulaires d’un diplôme d’État d’auxiliaire médical sanctionnant trois années d’études supérieures (comme les diplômes d’État d’infirmier, masseur-kinésithérapeute, ergothérapeute, orthophoniste…) que d’un master ou d’un doctorat d’un autre cursus.
5% des étudiants relèvent du dispositif Passerelle
Comme il n’est possible de déposer qu’un seul dossier au niveau national par année universitaire, le Francilien, qui souhaite changer de région avec sa compagne, candidate à l’université de Tours. Son dossier fait mouche. Lors de l’entretien oral, la motivation et la cohérence du parcours de Kévin finissent de convaincre le jury, ce qui lui vaut une place directement en 3ᵉ année. Comme lui, chaque année, des dizaines de passerelliens font leur rentrée en médecine : en 2024, dix-sept places leur sont réservées à l’université de Tours, quinze à Strasbourg, onze à Angers, dix à Brest et à Nice, cinq à Reims… Chaque université dispensant des formations en santé est chargée de mettre en place cette procédure. « La loi fixe le nombre de places offertes à 5% de la capacité d’accueil », précise le professeur Henri Marret, vice-doyen de la faculté de médecine de Tours et membre du jury depuis 10 ans. Ce dispositif n’est pas nouveau, même s’il a évolué au fil des années (ouverture aux auxiliaires médicaux, suppression de l’obligation d’exercice professionnel…) et conserve son objectif : permettre à des diplômés de tous horizons de postuler en études de santé. Généralement, « la moitié sont des professionnels de santé qui veulent changer de discipline ou des paramédicaux qui veulent évoluer dans leur carrière », remarque le professeur Henri Marret. Mais l’autre moitié est aussi issue « d’écoles de commerce ou d’ingénieurs, d’un master ou d’un doctorat, notamment en sciences… ».
Une diversité de profils, pas nécessairement scientifiques
Les connaissances scientifiques et médicales ne sont pas un prérequis obligatoire pour l’accès aux études de santé, mais constituent un atout, lit-on sur les différents sites des universités. De la même manière qu’un stage dans le domaine de la santé sera valorisé par le jury. « On sélectionne des candidats qui ont de bonnes capacités d’apprentissage, car l’objectif n’est pas de les mener à l’échec, résume le professeur Henri Marret, mais d’en faire de bons praticiens, faisant preuve de bienveillance et d’empathie. » Ce dispositif, bien que sélectif (4 à 5 candidatures pour une place en moyenne, à Tours) offre une belle opportunité pour les candidats qui souhaitent se reconvertir. De la même façon, la diversité des profils constitue « une chance pour la faculté » soutient le professeur Jean Dellamonica, doyen de l’UFR de médecine de l’Université de Nice. D’autant plus dans un contexte de pénurie de médecins, mais aussi de pharmaciens avec 471 places laissées vacantes à la rentrée 2023. Et ce n’est guère mieux en études de maïeutique, préparant au métier de sage-femme, où près de 10% des places en 2ᵉ année ne sont pas pourvues cette année. C’est justement vers le métier de sage-femme que Benoîte, 24 ans, s’est (ré)orientée après un master en littérature jeunesse. Alors qu’en terminale, la jeune fille avait fermement décidé de s’écarter de la voie tracée par sa famille – un père infirmier et une mère gynécologue – elle se sent désormais attirée par ce même univers.
Bien que publique, la formation engendre des coûts
Après son master, elle s’est octroyé une « année sabbatique » et a multiplié « les stages d’observation en libéral et à l’hôpital » avant d’effectuer « un volontariat de deux semaines dans une maternité au Tchad ». De quoi la convaincre que ce sera ce métier ou rien. Pourtant, sans Passerelle, elle n’aurait peut-être pas sauté le pas, car, « après cinq ans d’études, ça m’aurait fait peur d’entamer une première année de PASS ou de L.AS avec le risque de ne pas être prise en 2ᵉ année ». Grâce au dispositif, Benoîte pourra exercer le métier de sage-femme après quatre années d’études, contre les cinq (et même six, à partir de la rentrée 2024) prévues initialement. Mais, alors qu’à son âge, les premiers salaires donnent des ailes pour quitter le nid familial, Benoîte, étudiante à l'école de sage-femme de Brest, doit vivre chez sa mère. Bien que publique, la formation engendre des coûts : 175 euros de frais d’inscription en licence et 250 euros en master auxquels s’ajoutent 103 euros de CVEC (tarifs 2024/2025). En formation continue, la note grimpe avec un coût annuel moyen de « 4 890 euros par année de formation », selon l’association nationale des étudiants sages-femmes (ANESF). Si certaines régions « comme les Pays de la Loire financent l’intégralité des places des établissements de formation, dont les places du dispositif passerelle » explique l’association, ce n’est pas le cas partout. Sans compter les frais annexes, car « on doit parfois faire beaucoup de kilomètres pour se rendre sur notre lieu de stage » pointe Benoîte. Et ça coûte. L’ANESF estime les frais de transport des stagiaires à 12 850 euros pour un total de 25 700 km parcourus pendant le cursus.
Le poids financier de ce type de reconversion
De son côté, Kévin, même s’il perçoit les allocations chômage de son précédent emploi, reconnaît le sacrifice financier que ce type de reconversion engendre. « Ce n’est qu’à partir de la 4ᵉ année de médecine que les étudiants commencent à percevoir une indemnisation », précise l’étudiant qui commencera son externat l’année prochaine. Cette indemnisation oscille entre 273 euros bruts mensuels en première année d'externat et 409 euros en troisième année. En parallèle, les étudiants éligibles peuvent percevoir une bourse sur critères sociaux du CROUS. Puis, à partir de la 7ᵉ année de médecine, les étudiants deviennent internes : salariés de l’hôpital, ils perçoivent alors une rémunération. « Pour financer ses études de santé, il est possible de demander à bénéficier d’un contrat d’engagement de service public (CESP) » rappelle le professeur Jean Dellamonica. En échange d’une allocation mensuelle de 1 200 euros pendant leurs études, les étudiants s’engagent, une fois diplômés, à exercer dans une zone où l’offre médicale se révèle insuffisante. Depuis 2024, le CESP est accessible dès la 2ᵉ année d’études de médecine, d’odontologie et s’est même étendu aux études de maïeutique et de pharmacie. En parallèle à leur reprise d’études, certains passerelliens se voient contraints à poursuivre leur activité professionnelle pour des raisons financières. Un pari risqué tant les études de santé se veulent exigeantes et impliquent « un investissement à temps plein ».
Des études loin d’être une promenade de santé
« On n’a pas énormément d’heures de cours, reconnaît Kévin. Mais beaucoup de travail personnel. En médecine, ce n’est pas la même façon d’apprendre qu’en études d’ingénieur, c’est beaucoup de par cœur. » Sans compter que les étudiants admis via le dispositif passerelle suivent les mêmes cours que les autres étudiants, à charge pour eux de rattraper les cours de(s) première(s) année(s). « Ce n’est pas insurmontable, cela peut se faire de manière progressive, au fil de l’eau » explique Kévin qui compte tout de même y consacrer une partie de son été. Certaines universités, à l’instar de celle de Tours, proposent des tutorats spécifiques pour les étudiants admis via le dispositif Passerelle. De son côté, Kévin compte sur l’entraide des autres passerelliens de sa promo : « on a des parcours assez proches et on a créé un petit groupe de travail, ce qui ne veut pas dire que l’on ne côtoie pas les autres étudiants, au contraire, on crée du lien avec toute la promotion même s’ils sont plus jeunes que nous. » Et d’ajouter qu’à 30 ans, « on s’intègre différemment, car on ne court plus toutes les soirées étudiantes (rires) ». Il faut tenir le rythme. Si les études de santé ouvrent leurs portes sans limites d'âge, c’est au prix d’une course de fond. Six ans pour la maïeutique, 6 à 9 ans pour l’odontologie et 9 à 12 années pour la médecine… on est très loin d’une promenade de santé.